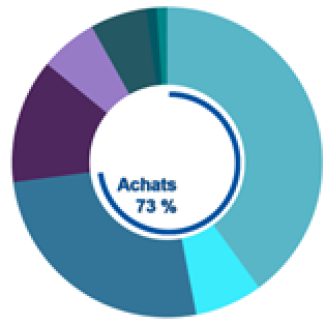
Sandra Laugier, philosophe : « Les citoyens doivent être impliqués dans les réflexions sur les sujets qui les concernent »
Chargée de mission Sciences en société auprès du président du CNRS, Sandra Laugier dresse un premier bilan des actions conduites dans ce domaine. Elle annonce notamment la création d’un groupe de travail pluridisciplinaire sur les controverses centrées sur des questions scientifiques.
Vous avez été nommée chargée de mission Sciences en société en mai 2016 dans la foulée de réflexions préalables au rapport d'évaluation du CNRS qui relevait, sinon des manques, du moins des progrès à réaliser dans ce domaine. Quels sont l'objet et la feuille de route de cette mission ?
Sandra Laugier : Les dernières années ont vu une évolution vers une implication plus forte des chercheur.e.s et du CNRS dans la société. Cela a commencé par un passage à de nouveaux modes de communication et de nouvelles opérations (CNRSlejournal.fr, le Forum du CNRS « Que reste-t-il à découvrir ? », la revue Carnets de science), destinés à transmettre au public la science fondamentale, qui inclut les sciences sociales. Cette méthode a des conséquences, puisqu'elle suppose de donner ou reconnaître aux citoyen.ne.s la capacité de s’approprier ces contenus, de changer notre rapport au « public », désormais acteur plus que récepteur. Ensuite, le CNRS a contribué aux grands défis de société à travers les actions de la Mission pour l’interdisciplinarité (numérique et big data, transition énergétique et climat, genre et inégalités, comportements sociaux...). Et depuis 2015 par sa contribution à la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité humaine (rapport ATHENA concernant la recherche sur la radicalisation, appel attentats-recherche, défi science des comportements humains collectifs...), le CNRS a pris un nouveau rôle public, tout en consolidant son rôle de référence nationale – scientifique et éthique. Il s'agit maintenant de réfléchir collectivement aux enjeux, limites et conséquences de ce positionnement. Comment un organisme de science fondamentale – et qui entend le rester – peut-il avoir une place et une action dans la société ? Notre mission consiste donc à montrer comment cette science fondamentale peut et doit être mise en œuvre – mise en société – notamment en humanités et sciences sociales. D'où un certain nombre de nouveaux défis pour nous : décloisonner les structures, impliquer les citoyens dans les questions qui les concernent, trouver des relais et partenaires dans la société – que ce soit dans le monde politique, associatif, ou celui des entreprises.
Le CNRS cherche à valoriser ses recherches dans le domaine des humanités et des sciences sociales tout particulièrement dans les politiques publiques. Comment votre mission peut-elle y contribuer ?
S. L. : Paradoxalement, les chercheur.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s en sciences humaines et sociales ne sont, guère plus que les autres, prêts à s'engager dans le domaine des politiques publiques. Il y a à cela beaucoup de raisons, dont le refus des compromissions, mais d'autres moins explicitées, telle cette tendance à se positionner hors sol, à se protéger dans un espace propre à la recherche, en négligeant le contexte local ou les « besoins » de sa société. Mais ce sont les budgets des États qui financent la recherche de base. La pertinence de la recherche n'est pas détachée du bien-être des acteurs qui l’environnent.
Récemment, nous avons collectivement pris conscience de la faiblesse des processus de transferts des connaissances vers les pouvoirs publics. Il faut sortir du modèle « think tank », « conseiller du prince » ou « comité d’experts », où politiques et scientifiques se confortent et se valorisent mutuellement pour au final ne rien proposer de nouveau. Tout ce système a exhibé son inefficacité, avant et depuis les attentats de 2015, avec la gestion de phénomènes tels que la « radicalisation ». Il s'agit maintenant de trouver, dans la continuité des propositions du rapport d’Alain Fuchs concernant les recherches sur la radicalisation, des formules nouvelles où chercheurs, citoyens, administrations et élus travaillent ensemble et co-construisent des solutions.
Le climat est un domaine où, de façon exceptionnelle, les politiques ont été capables de décider d’agir en fonction de ce que la science pouvait établir. Dans une période où l’obscurantisme scientifique peut être un outil de répression et d’injustice, il importe de faire reconnaître la science, l’explication, l’analyse comme moyens de décision et d’action.
Dans le cadre de votre mission, vous venez de lancer un groupe de travail sur les controverses (voir ci-dessous). Quel est son objectif ?
S. L. : Ce que les controverses centrées sur des questions scientifiques mettent en évidence – par exemple, le nucléaire ou les OGM –, c’est la difficulté pour certains sujets à établir une position unique « du CNRS », qu’on nous réclame rituellement. On voit parfois les controverses comme fragilisant la science, mais la réflexion du groupe semble montrer qu’elles sont aussi signe de santé et d’inventivité. Il faut aussi prendre en compte le fait que les sciences humaines et sociales, reconnues en tant que science comme les autres, et pas seulement comme supplément éthico-juridique ou comme service après-vente des autres domaines, conduisent à prendre en compte de nouveaux éléments ou données dans la connaissance, qu’on ne peut plus évacuer comme « non scientifiques ». C’est un des effets d’une interdisciplinarité véritable. Une expertise collective sur certaines controverses, telle que le CNRS peut désormais en fournir, peut et sans doute doit être pluraliste pour être utile, et pertinente pour un débat public. En gardant toujours à l’esprit le souci de favoriser la communication vers le public et en proposant différents types d’éclairages scientifiques sur des points particuliers.
Bien que toute récente, la mission Sciences en société a déjà été sollicitée sur plusieurs sujets importants, comme la prise en compte des personnes en situation de pauvreté dans les programmes de recherche qui les concernent, et les sciences participatives...
S. L. : Nous avons démarré avec le cas de la radicalisation, mais nous avons aussi travaillé avec le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, sur la violence et les femmes dans le contexte du djihadisme, ou encore, au-delà de la question du terrorisme, sur les violences incestueuses touchant les enfants – sujet pour lequel nous allons produire une expertise collective. Il est en effet nouveau que le CNRS soit saisi pour une expertise collective et c’est significatif d’un déplacement. On peut espérer que la réflexion sur le transfert des connaissances sera étendue à tous les domaines où la science peut agir sur la société. De même, le récent colloque organisé au CNRS avec ATD Quart Monde a montré de façon inédite l’importance de la prise en compte des compétences des personnes en situation de grande pauvreté dans les politiques, et dans l’élaboration des savoirs. C’est une façon d’aborder les sciences participatives par leurs enjeux épistémologiques et politiques fondamentaux : utiliser les connaissances et expériences des citoyen.ne.s pour les questions qui les concernent. C’est une bonne entrée en matière !


