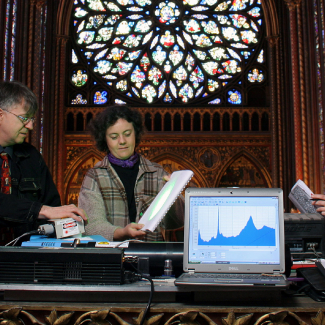
Europe et international
Grâce à son ancrage international, le CNRS participe à un grand nombre de découvertes majeures aux côtés de ses partenaires étrangers. Il prend part aux défis scientifiques et technologiques planétaires, dans le cadre d'une recherche mondialisée qui se développe sur la base de la libre circulation des scientifiques et des idées.
Un acteur de la science mondiale
A key player in international collaborative research
Audiodescription
La circulation des idées pour le rayonnement de la science
Le CNRS s'investit pleinement dans les échanges scientifiques à l'échelle mondiale. Il collabore avec des laboratoires étrangers notamment à travers de nombreuses publications, contribuant ainsi à promouvoir la science française tout en favorisant les avancées de la recherche à l'échelle internationale.
La mobilité des talents sans frontières
La qualité des emplois et la grande liberté de recherche garanties par le CNRS exercent une forte attractivité parmi les jeunes scientifiques, qu’ils soient français ou étrangers. Très mobiles, les chercheurs et chercheuses du CNRS se déplacent régulièrement pour assister à des colloques internationaux, mener des recherches dans un laboratoire partenaire ou accéder à un terrain de recherche. Le programme "fellows-ambassadeurs" permet aussi à des personnalités scientifiques reconnues internationalement de venir dans des laboratoires du CNRS pour renforcer leurs collaborations avec les communautés françaises.
Le pilotage de la politique internationale
La politique du CNRS à l’international privilégie une approche « bottom-up » nécessaire à la dynamique de la recherche. Les coopérations naissent sur le terrain et résultent de l’intérêt des scientifiques et des équipes dans les laboratoires. L’institution apporte une plus-value en matière d’accompagnement pour aider à développer les projets grâce à des dispositifs qui permettent de structurer et d’approfondir les collaborations scientifiques.
Une présence active sur le terrain
Le CNRS anime un réseau de 11 Bureaux situés dans des lieux clés de la science mondiale : à Bruxelles, Melbourne, Nairobi, New Delhi, Ottawa, Pékin, Pretoria, Sao Paulo, Singapour, Tokyo et Washington.
Cette présence internationale poursuit des objectifs multiples :
- Promouvoir l’excellence scientifique française
- Apporter un appui aux chercheurs et chercheuses expatriés ou en mission
- Suivre les accords de coopération et faciliter les relations avec les partenaires étrangers, en lien avec les services scientifiques et culturels des ambassades.
Des outils de coopération attractifs
Des partenariats adaptés aux besoins des chercheurs
La souplesse est clé pour s’adapter aux évolutions de la science mondiale et répondre aux besoins de celles et ceux qui la mènent. C’est pourquoi le CNRS propose des dispositifs de partenariats internationaux variés : accords bilatéraux, coopérations scientifiques à long terme, constitution de réseaux de recherche internationaux autour de projets associant des équipes de différents pays, etc.
Découvrir comment le CNRS collabore avec les entreprises
Des structures de recherche dans le monde entier
Le CNRS est l’une des rares institutions de recherche au monde à créer des structures de recherche collaboratives pérennes à l’étranger. Celles-ci peuvent prendre différentes formes : laboratoire de recherche international (IRL), unité mixte des instituts français de recherche à l’étranger (Umifre) en sciences humaines et sociales, pilotée en partenariat avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ou encore centre de recherche international (IRC).
Les centres internationaux de recherche (IRC)
En 2021, le CNRS a conçu une nouvelle façon de coopérer avec certains partenaires internationaux prestigieux. Ces centres internationaux de recherche (IRC) permettent un dialogue stratégique et reposent sur une ambition claire : définir des intérêts partagés pour mutualiser les moyens et les expertises avec des projets communs et co-financés. Le CNRS compte aujourd’hui 6 IRC.
Nos centres internationaux de recherche
En 2021, le CNRS a conçu une nouvelle façon de coopérer avec quelques uns de ses principaux partenaires internationaux, à travers ses International Research Centres (IRC). Ces partenariats stratégiques reposent sur une ambition claire : mutualiser les moyens et les expertises du CNRS et de son partenaire pour consolider les collaborations déjà existantes entre les deux institutions, tout en ouvrant la voie à de nouveaux projets inter et transdisciplinaires identifiés conjointement.
Audiodescription
Les Laboratoires de recherche internationaux (IRL)
Véritables laboratoires situés au sein des universités partenaires, les IRL regroupent des équipes de chercheurs, étudiants, post-doctorants, ingénieurs et techniciens issus à la fois du CNRS et d'institutions partenaires étrangères. Parmi les 80 IRL que compte le CNRS dans le monde, 4 ont été créés en partenariat avec l’industrie autour de programmes d’innovation, en vue de créer un environnement propice à l’émergence de technologies du futur.
L’IRL Cintra à Singapour, avec Thales
Recherches sur les nanotechnologies, l'électronique, la photonique du futur et les applications associées, en partenariat avec le géant de l'aérospatiale, de la défense, de la sécurité et du transport terrestre.
L’IRL E2P2L à Shanghai, avec Solvay
Recherches sur la chimie verte, en partenariat avec un grand nom de la chimie mondiale.
L’IRL Link à Tsukuba au Japon, avec Saint-Gobain
Recherches autour des matériaux innovants, en partenariat avec le leader mondial en matériaux innovants pour l’habitat.
L’IRL Compass en Pennsylvanie, aux États-Unis, avec Solvay
Recherches sur la création, la manipulation et la compréhension de la matière molle, en partenariat avec le référent des matériaux avancés et de la chimie de spécialités.
Europe de la recherche
Une stratégie institutionnelle ambitieuse
Pour maintenir son implication et accroître sa participation aux programmes de financement de la recherche et de l’innovation, le CNRS déploie depuis 2021 un plan d’action européen ambitieux, qui se traduit par plusieurs volets :
- mise en place de dispositifs d’incitation et de soutien aux chercheurs et chercheuses souhaitant soumettre des projets européens
- travail de communication et d’influence au plus près des institutions bruxelloises, en s’appuyant sur son Bureau à Bruxelles.
Le CNRS, acteur majeur de l’Espace européen de recherche
Les financements européens en recherche et innovation renforcent la compétitivité et l’attractivité de l’Union européenne dans le monde, stimulent la coopération entre les chercheurs et chercheuses des différents États membres, et favorisent in fine les avancées scientifiques qui seront les innovations de demain.
Acteur majeur de l’Espace européen de la recherche (EER), le CNRS est le premier bénéficiaire de ces programmes européens de financement de la recherche et de l’innovation, notamment d’H2020 (2014-2020) et de l’actuel programme Horizon Europe (2021-2027).
Des projets collaboratifs pour répondre aux grands défis sociétaux
Dans le cadre d’Horizon Europe, le CNRS participe activement aux projets collaboratifs de recherche qui visent à répondre à six grands défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain: santé ; culture, créativité et société inclusive ; sécurité civile ; numérique, industrie et espace ; climat, énergie et mobilité ; alimentation bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement.
En savoir plus sur le programme Horizon Europe
L’Europe innovante
Face à une intense compétition internationale, l'Union européenne doit se positionner comme un acteur clé de l’innovation à l’échelle mondiale. C’est un engagement nécessaire qui ouvre des perspectives de croissance économique pour le continent tout en garantissant sa souveraineté technologique pour faire face aux grands défis de demain. Pour atteindre cet objectif, le programme Horizon Europe finance des projets à forte intensité de recherche et développement, et accompagne activement les startups et les entreprises dans la mise sur le marché de leurs innovations. Au cœur de cet effort, le Conseil européen de l'innovation (EIC) identifie, développe et accélère les technologies et innovations révolutionnaires. Depuis 2019, plus de 458 millions d’euros provenant des financements de l’EIC ont soutenu des start-up issues des laboratoires du CNRS.
Pour une science européenne d’excellence
Les bourses du Conseil européen de la recherche (ERC)
Créé en 2007, le Conseil européen de la recherche finance des travaux de recherche exploratoires audacieux, à travers des bourses de recherche individuelles, attribuées sous réserve que les travaux de recherche financés soient menés au sein d’une institution européenne : les bourses ERC. Leur sélectivité en fait une marque de reconnaissance de l’excellence des travaux menés. Le CNRS en est la première institution bénéficiaire avec plus de 650 projets lauréats menés dans ses unités depuis la création de cette bourse.
Les Actions Marie Sklodowska-Curie (AMSC)
Centrées sur les mobilités internationales des chercheurs et chercheuses et sur la mise en valeur de leurs carrières dans le monde académique et non académique, les Actions Marie Sklodowska-Curie (AMSC) sont un levier essentiel pour développer les collaborations internationales, mais également entre chercheurs et chercheuses du public et du privé.
Les Infrastructures de Recherche
Les infrastructures de recherche fournissent des ressources et des services qui sont utilisés par de nombreuses communautés scientifiques pour mener leurs travaux. En France, le CNRS cogère 80 % des infrastructures nationales. L'Europe dispose quant à elle d'un parc dense et varié de ces grands équipements de pointe, qui bénéficient à l’ensemble des chercheurs et chercheuses et leur permettent de mener des travaux de grande ampleur. Découvrez comment le CNRS y participe.
Crédit photo : © Bruno JOURDAIN/LGGE/CNRS Images

